
Fiche technique :
- Titre original : Sugata Sanshiro
- Titre : La Légende du grand judo
- Réalisation : Akira Kurosawa
- Scénario : Akira Kurosawa, d'après le roman de Tsuneo Tomita
- Interprètes : Denjirô Ôkôchi, Susumu Fujita
- Production : Keiji Matsuzaki
- Société de production : Toho
- Musique : Seiichi Suzuki
- Photographie : Akira Mimura
- Pays d'origine : Japon
- Durée : 80 minutes
- Date de sortie : 25 mars 1943 (Japon)
On a coutume de voir dans le judo (art martial) une catharsis de la guerre, autrement dit une sorte d’imitation de celle-ci afin de purger les instincts belliqueux, voire meurtriers. A ce titre, le judo n’est évidemment pas la guerre, loin s’en faut, mais il en a la couleur et lui est relatif. En effet, à l’inverse de nombreux sports, la pratique d’exercices destinés à la maîtrise du judo ne trouve pas son origine dans un domaine ludique ou médical. Au contraire, c’est l’instinct de conservation des hommes, soumis à la loi du plus fort qui caractérisait les guerres féodales, qui a donné naissance aux premières techniques et méthodes de combat au corps à corps. Le Moyen Age nippon, si chaotique et violent avec ses guerres de samouraïs, ses hors-la-loi et son instabilité politique, est ainsi au cœur de l’avènement du Judo. Pour donner une image, le Moyen Age japonais évoquait sous bien des aspects, et à peu près à la même époque, le Far West américain comme milieu inorganisé, sans lois ni règles. En un mot, une forme d'état de nature. Nous pouvons ici nous souvenir que les scénari de grandes œuvres cinématographiques du maître Akira Kurosawa tels que Les Sept Samouraïs ou Le Garde du Corps, furent rachetés, respectivement en 1960 et 1964, par les réalisateurs américains John Sturges et Sergio Léone, qui les transposèrent dans l’univers du western et mirent ainsi en scène deux des plus célèbres classiques du genre que sont Les Sept Mercenaires et Pale Rider. Le judo sous cet angle peut être envisagé comme l’enfant dialectique de la guerre qui, dans son sens le plus propre, implique l’épreuve de la probabilité permanente de la mort violente pour soi comme pour autrui (symbolisé par le ippon.) Il y a tout en bas de l’arbre généalogique de l’art de la souplesse la volonté omniprésente et ancestrale de ne pas mourir. Autrement dit survivre et durer sont les impératifs qui donnèrent, de loin en loin, naissance au judo.
Voici en substance les enjeux présents dans le film La Légende du Grand Judo.
Si nous examinons un peu plus en détails l’avènement du judo, (sans pour autant avoir la prétention d’être exhaustif), tout en resituant le contexte historique que le film nous donne à voir, nous constatons aisément que le Ju-Jutsu est l’ancêtre le plus proche du judo, une sorte de père devenu un peu trop âgé et rigide, mais qui toutefois avait eu le mérite de procéder à un premier tri et à une première codification des méthodes de combat issues des Samouraïs, duquel le fils prodige s’est, non sans mal, émancipé. [Précisons que même s’il existe une filiation spirituelle entre les deux termes, il ne faut pas confondre le Ju-jutsu et le Jujitsu. En effet, le premier renvoi au style ancien et authentique tandis que le second correspond à l’invention récente d’une discipline sportive modernisée pour les besoins de la compétition. Ainsi, au long de ces quelques lignes, conserverons-nous le terme Ju-jutsu originel, quand bien même en France on a coutume d’écrire le japonais comme on le parle, « Ju » se prononçant « Jiu », et d’orthographier « Jiu-jitsu », ce qui est une erreur étymologique]. La rivalité entre judo et Ju-Jutsu commence d’ailleurs un peu comme un récit mythologique où le fils insoumis assassine son père puis digère le corps pour s’approprier sa force et sa vertu. Le sol originel du judo est, à ce titre, un véritable parricide. Il faut donc remonter au mois de février de l’hiver 1882, An 15 de l’ère Meiji, pour que le terme judo apparaisse pour la première fois dans sa forme moderne grâce à un jeune étudiant nommé Jigoro Kano. Tout d’abord, rappelons que « l’ère Meiji » (« gouvernement éclairé »), qui débuta en 1868 par l’installation à la tête du pays de l’empereur Mitsu-Hito et qui s’acheva en 1912, correspond à la véritable création du Japon moderne. En effet, succédant à l’époque « d’Edo », qui avait vu le pays se replier progressivement sur lui-même pendant plus de deux siècles et demi à cause d’une politique intolérante, jusqu’à se fermer hermétiquement, à partir de 1639, à tout contact avec le monde extérieur, l’« ère Meiji » fit souffler un vent nouveau, à tous points de vue, sur un Japon sclérosé (Il est nécessaire de souligner ici le rôle déterminant joué par les Expositions Universelles auxquelles le Japon participa et qui lui permirent de se comparer aux autres nations : Paris en 1867, San Francisco en 1871 et Vienne en 1873 furent ainsi de sérieux électrochocs pour le peuple nippon.).

La terminologie même de ce « gouvernement éclairé » implique que ses prédécesseurs ne l’étaient pas, ou l’étaient moins, c’est pourquoi il se devait de tout changer, à la mesure des transformations qui secouaient à l’époque l’Asie orientale. Le premier facteur à intervenir dans cette rénovation, ou plutôt cette implosion des murailles mentales qui caractérisaient le Japon fut d’abord l’influence des pays étrangers. Ainsi à Edo, rebaptisée Tokyo, on accueilli à cette période de nombreux intellectuels, savants et techniciens du monde entier dans le but de rattraper le retard culturel et technologique du pays. En 1869 fut crée l’université de Tokyo, précédent de trois ans l’institution de l’enseignement obligatoire. Vers 1875-1880, les philosophes européens majeurs tels que Nietzsche et Kant furent pour la première fois publiés. On vit, également vers le milieu de la seconde moitié du XIXe siècle, l’apparition d’un théâtre nouveau, basé sur le réalisme, qui supplanta le théâtre de nô (drame lyrique de caractère religieux), typiquement japonais, basé sur la tradition. La mode vestimentaire changea pour se mettre à l’heure de l’Occident (hauts de forme, gants et costumes). Les femmes nippones gagnèrent davantage d’autonomie et de liberté. Tous ces indices de changement apparaissent en filigrane de façon très instructive dans le film de Kurosawa. Egalement, fait déterminant, le port du sabre fut interdit à partir de 1876, sauf pour les officiers de l’armée. En 1889, Meiji-Tenno, ( nom posthume donné à l’empereur Mutsu-Hito), avait déjà abolit le shogunat des Tokugawa ( famille noble japonaise qui donna, de 1603 à 1868, quinze shogun au pays du Soleil levant, autrement dit quinze dictateurs militaires) et commencé à réformer sérieusement les institutions féodales lorsqu’il accepta d’offrir au Japon sa première constitution de type moderne : Les privilèges féodaux furent abolis, les fiefs furent remplacés par des préfectures et les castes furent abrogées. Evidemment, derrière ce tableau enchanteur se cache un scepticisme de tous les jours, exacerbé par de nombreuses vagues d’idées réactionnaires, qui n’allèrent pas sans poser certaines difficultés d’ordre culturel. Ainsi la transformation ne se fit pas sans douleur et, dans bien des cas, sans regret.
C’est donc dans ce climat où se joue le conflit des anciens et des modernes qu’apparaît l’avènement du Judo, ainsi que ses enjeux originels. Pour schématiser, il y a d’un coté le Ju-Jutsu et de l’autre, le nouveau judo. Et passer de l’un à l’autre n’est pas, comme nous allons le voir, une simple formalité. Souvenons-nous que le vieux Ju-Jutsu est l’art de la guerre le plus typique du Japon. S’il est impossible de dater avec précision l’apparition du Ju-Jutsu, on sait qu’il commença à prendre une certaine importance à partir du milieu de « l’Epoque de Muromachi » (1392-1573), période qui correspond relativement, comme nous le disions plus haut, à ce que l’on peut imaginer d’un « Far West nippon », (c’est à dire luttes féodales incessantes, désordres sociaux et chaos urbains) ; et s’installa dans le paysage nippon tout au long de « l’Epoque Momoyama » (1578-1615). Pour l’essentiel, le Ju-Jutsu prit ses premières bases techniques auprès des méthodes de combat des Samouraïs, qui combattaient à l‘arme blanche, le katana. Mais il arrivait aussi que les guerriers soient désarmés. Ils combattaient alors à mains nues en projetant, disloquant ou étranglant. Au fil du temps, un certain nombre d’entre eux mirent au point des techniques de corps à corps, basées sur des notions d’esquives et de déséquilibres, ainsi que sur des connaissances anatomiques, qui leur permettaient de mettre leurs opposants définitivement hors de combat. Que ce soit avec ou sans arme, soyons précis, il s’agissait de terrasser physiquement son adversaire et cela, à cette époque, engendrait fréquemment la mort. Nous insistons sur cette donnée : le judo est né d’un besoin impérieux de rester en vie. De nos jours, on ne meurt plus sur les tatamis, même s’il arrive encore parfois malheureusement qu’un uchi-mata (Projection par l’intérieur de la cuisse) mal exécuté (tête dans le tapis) brise les cervicales du combattant et le condamne à un fauteuil roulant. Mais au XVIe siècle, pratiquer le Ju-Jutsu pouvait s’avérer être une activité mortelle. Néanmoins, dans la mesure où il s’agissait principalement de durer, on assista à cette époque à l’ouverture de quelques écoles spécialisées, reparties de manière éparse sur tout le territoire. Même si nous sommes encore loin de sa forme définitive, c’est précisément à ce stade que la colonne vertébrale du judo s’est dessinée.

Cependant, c’est durant l’époque suivante, dite « Epoque d’Edo » (1615-1868), que le Ju-Jutsu connaîtra son développement le plus hardi et le plus fécond. C’est aussi à ce stade que la fréquentation du dojo (littéralement, « le lieu où l’on apprend la voie. » (salle d’entraînement) vînt supplanter, comme peut le faire un placebo sur la psyché humaine, celle des champs de bataille.( La salle d’armes, en escrime, a connu un pareil phénomène). De nombreux samouraïs, de retour de campagnes et désœuvrés, s’orientèrent alors vers les dojos et diluèrent ainsi leurs méthodes de combat dans le vieux Ju-Jutsu. On dirait, de nos jours, que le « recyclage » de ces farouches batailleurs fut particulièrement difficile : formés dés leur plus jeune âge à cette orientation guerrière, ils ne savaient rien faire d’autre. Quelques uns s’obstinèrent dans leur mode de vie et tentèrent, sans succès, une rébellion. Pour la plupart, leur seule ressource fut souvent d’enseigner les arts martiaux, ce qui semblait plus compatible avec leur éducation, que de se livrer à des travaux manuels ou de tirer des « pousse-pousse », comme ce fut parfois le cas, ou même encore de donner à la nation ses premiers clochards. La main d’un héros ne tolère pas l’inactivité. Cette idée, et ses conséquences, se trouvent notamment illustrées dans la tragédie grecque par le thème du retour des héros de la guerre de Troie : ceux-ci, ayant toujours fait valoir leurs talents militaires sur le mode de l’excès, ne parviennent plus à se plier aux règles de la vie de la cité fondées sur la mesure. Des siècles plus tard, les samouraïs nippons connaîtront une pareille inadaptation. Dés-lors, le Ju-Jutsu ( ainsi que le judo dont il est la genèse ) peut être perçu comme un art d’équilibre : réussir le mariage improbable de l’excès et de la mesure. De cette façon, au moment où la guerre s’éloignait, les hommes la firent perdurer dans une configuration plus neutre et plus noble. Peut être pouvons-nous ici envisager le problème de la confrontation des vertus civiles et des vertus militaires pour expliquer cette tendance. En effet, en plongeant les hommes dans l’élément même de leur finitude tout en leur offrant brusquement la maîtrise de la vie d’autrui, la guerre est saisie comme un des lieux où se détermine l’idée de la vertu. Et ce terme de « vertu », nous allons le voir, est tout à fait fondamental quant à la constitution du Ju-Jutsu et la gestation du grand Judo.
Tout d’abord, notons qu’il faut plutôt entendre ce terme à la manière de Machiavel, qui l’orientait dans le sens d’une volonté efficiente, qu’à la manière des stoïciens qui l’inscrivaient essentiellement dans une lutte contre les passions. Etymologiquement, la vertu (du latin classique virtus ) signifie « homme », « courage », « énergie morale » et, par extension, « pouvoir », « force », « principe d’efficacité ». Ainsi, au sens général, la vertu est une puissance active ou encore un pouvoir de faire. Connoté moralement, ce qui n’est pas rien lorsque l’on étudie un art du budo, ce pouvoir devient une détermination permanente à faire le bien et impose nécessairement un effort sur soi ( courage et maîtrise ). Toute vertu est donc une qualité de l’esprit qui implique courage et maîtrise de soi. Néanmoins, elle ne s’apparente pas à un principe rigide qui maintiendrait de force dans la voie du bien, ( les samouraïs n’en étaient d’ailleurs sûrement pas capables), mais à une force d’âme orientée dans le sens de la volonté efficiente et de l’effectivité. Et cette effectivité, pour un samouraï du Moyen âge c’est tout naturel, consistait à vaincre. Revenus de la guerre, les mains encore ensanglantées, les samouraïs transmirent cette vertu au Ju-Jutsu et à travers elle, comme à travers un filtre, ils mirent en place son véritable code moral, dont les piliers sont le courage et la maîtrise de soi. Le côté sauvage de la vertu étant dompté, on ne fera plus la guerre mais le sport. Aujourd’hui encore, et nous y reviendrons, le code moral du judo est très prégnant, tant lorsqu’il s’agit de le pratiquer que dans la vie de tous les jours. Le Ju-Justu et le judo sont ainsi des arts martiaux par excellence. De même, la recherche de l’efficacité s’avère primordiale. Mais bien sûr, en pleine « période d’Edo », et malgré cette avancée morale, nous ne sommes pas encore au point de parler d’élévation spirituelle. Autrement dit, nous n’avons pas à cette époque dépassé dans la technique le stade de l’efficacité visible en soi. Cependant, le XVIIe siècle nippon constituera bel et bien l’âge d’or du Ju-Jutsu. Celui-ci devenant progressivement l’un des éléments de la vie quotidienne des japonais de l’époque, au même titre que le « chanoyu » (la voie du thé) et l’ « ikebana » (art floral). De nombreux experts, samouraïs et maîtres d’armes, initiés au Ju-Jutsu autant qu’ils l’initièrent, fondèrent une floraison d’écoles portant leur nom et formèrent des élèves qui, à leur tour, ouvrirent des écoles. Selon la légende, les rivalités entre écoles, en ce temps-là, étaient monnaie courante et les techniques les plus efficaces devenaient aussi de véritables trésors gardés secrets entre les murs du dojo de telle ou telle école, l’effet de surprise assurant souvent la supériorité. ( C’est pourquoi il n’existe quasiment aucun document ancien décrivant ces techniques). D’incessants défis étaient lancés et, nous le répétons, leurs issues étaient souvent mortelles. La tradition voulait que les vainqueurs emportent avec eux l’enseigne de l’école des vaincus. Le dojo de ces derniers, discrédité, perdait alors presque tous ses élèves. Le Ju-Jutsu marquait les esprits. Dés lors, les techniques de combat progressèrent, gagnèrent en efficacité et s’affinèrent au point de jeter les bases définitives de ce qu’allait être le judo. Selon R.Habersetzer, (Petite Histoire du Judo, édition Amphora), l’école Tenjishinyoryu classa à cette époque les techniques de katame-waza (immobilisations), de shime-waza ( étranglements ) et de atémi-waza ( coups frappés ) qui seront le terreau sur lequel J.Kano érigera le judo moderne. De même, toujours selon R.Habersetzer, le principe de nage-waza ( projections ), principe de la souplesse, était la base de l’école Yoshin-ryu ( école du cœur de saule ), fondée par Shirohei Akiyama. Humblement, nous n’entrerons pas ici plus en avant dans les détails technico-historiques du vieux Ju-Jutsu. Simplement, puisqu’il s’agit de situer la genèse du judo, rappelons brièvement que « l’ère Meiji », en 1867, allait bouleverser les traditions féodales, et par là même, mettre fin à la Belle Epoque du vieux Ju-Jutsu.

Le début de « l’ère Meiji » fut une période sombre pour les arts martiaux puisque l’Empire du Soleil levant s’ouvrait à toutes les influences étrangères et rejetait ses propres traditions. La vague de modernisme supplanta les arts conventionnels et folkloriques comme le Ju-Jutsu et beaucoup d’écoles dont le prestige avait disparu durent fermer. C’est à ce stade de l’histoire qu’apparaît la figure de Jigoro Kano (1860-1938), dont on salue toujours le portrait en début et en fin de chaque leçon dans n’importe quel dojo du monde. Si l’on scrute le cliché, qui date de la fin de sa vie, on voit un petit homme au visage bien dessiné, sans âge, de type japonais, arborant une moustache blanche comme ses cheveux, qui fixe l’objectif d’un regard serein, d’une intensité presque intimidante mais néanmoins bienveillante. On se dit que ce regard n’a manifestement pas cillé souvent. Le port de tête et la rectitude des épaules sont d’une étonnante rigueur. C’est, en un mot, la figure du père. On le présente volontiers comme un homme à forte personnalité, de nature chétive, universitaire, éducateur hors normes, philosophe et idéaliste.( En plus d’être le père fondateur, l’obstétricien du judo, J.Kano est connu pour avoir été Conseiller au Ministère de l’Education Nationale et Professeur à l’école Normale Supérieure, ce qui révèle ses ambitions, ainsi que pour avoir offert au Japon le Base-Ball professionnel dont il est aujourd’hui si friand, ce qui témoigne de son ouverture d’esprit.). Jigoro Kano est né le 28 octobre 1860 au village de Mikage dans le département de Hyogo. La date de naissance exacte de Jigoro Kano est en fait le 28ème jour du 10ème mois 1860. Le calendrier grégorien n’était pas en vigueur au Japon à cette époque. Il a sept ans lorsqu’abdique Yoshinobu, le dernier shogun de la dynastie Tokugawa dont nous parlions plus haut. A seize ans, il ne mesurait que 1,55m et ne pesait pas plus de 45 kg. On l’imagine ainsi, enfant, toujours battu au cours de ses querelles avec ses camarades, lorsqu’ils en venaient aux mains.
La légende que l’on aime rapporter aux petits judokas, et il est vraisemblable que ce récit ne soit pas autre chose, raconte qu’en hiver 1882, alors que la neige recouvrait d’un blanc manteau le Japon et qu’il n’était qu’un jeune étudiant à la faculté, Jigoro Kano méditait devant le spectacle de lourds flocons qui tombaient sur les arbres. En observant avec beaucoup d’attention les branches chargées de neige, il constata que les plus grosses avaient tendance à casser sous le poids de l’agresseur naturel, tandis que les plus souples, pliant elles aussi sous ce même poids, s’en débarrassait en un mouvement de retour et le rejetait en se dépliant. Ce fut sans doute une illumination pour le petit étudiant japonais lorsqu’il fit le constat suivant : le plus souple peut vaincre le plus fort. Le Judo était né. Ju-Do : un terme composé de deux mots. D’une part, « ju », qui renvoi au principe de la souplesse, aussi bien physique que mentale, déjà présent dans le Ju-Jutsu, et d’autre part « do », qui évoque la voie, le chemin à parcourir. Et c’est précisément ce suffixe « do » qui allait poser problème en symbolisant un changement d’orientation spirituel déterminant par rapport au Ju-Jutsu dont il est issu. En effet, en remplaçant le « jutsu », qui signifie l’art de la technique, par le « do », qui rappelle la voie vers la perfection, Kano voulait métamorphoser l’art de l’agilité en voie de l’agilité, provoquant ainsi une césure avec les mœurs en place. (Rappelons qu’au fur et à mesure des quatre siècles précédents, le Ju-Jutsu s’était installé dans la vie et la mentalité du peuple nippon). Or, envisager ce changement revenait à rompre avec une certaine tradition selon laquelle les techniques devaient demeurer secrètes, le « do » induit par Kano impliquant la possibilité d’un enseignement, ou plus précisément d’une initiation. Ainsi Kano avait-il pour dessein de former une nouvelle jeunesse et le judo était son instrument. Il passait donc à l’époque aux yeux des traditionalistes pour un instructeur intello, un jeune prétentieux moderniste, un ramenard progressiste qui voulait enseigner aux classes laborieuses l’art du combat au corps à corps et éventer tous leurs secrets. Le judo était alors considéré comme profane, mettant outrageusement à disposition des plus faibles les connaissances spéciales qui permettent de vaincre les plus forts. C’est pourquoi, loin de l’image idyllique de la légende des branches souples sous la neige, il faut voir dans la naissance du judo un enjeu politique.
Revenons donc au début de l’histoire, en 1877. Jigoro Kano est adolescent, il a à peine 17 ans et débute des études de sciences politiques et économiques à l’université impériale de Tokyo. Dans le même temps, recommandé par un des ses condisciples, Teinosuke Yagi, il se rend auprès du sensei Hachinosuke Fukada pour s’initier au ju-jutsu de l’école Tenjin-Shinyo, fondée par Iso Mataemon. (Maître Iso Mataemon était en ce temps là était un véritable mythe à lui tout seul, reconnu et admiré pour son immense science du combat. La légende, qui fit beaucoup pour sa popularité, raconte qu’aidé par un seul de ses disciples, Mataemon, dans un combat à cent contre un, décima une troupe entière de mercenaires qui rançonnaient les campagnes. M. Fukada était un maître de caractère viril, très fort dans ses projections, et qui ne donnait que peu d’explications. Il enseignait par l’exemple et ses élèves devaient comprendre par eux-mêmes). Cette méthode convenait parfaitement à Kano. (Par la suite, le jeune homme fréquentera d’autres écoles). Parallèlement à cet engouement pour l’art de combat traditionnel nippon, Kano développe un intérêt grandissant pour d’autres disciplines sportives, à consonances plus occidentales, nouvellement accessible sous « l’ère Meiji ». Il faut dire que la curiosité était une constante chez lui. Ainsi, il eut à cette époque l’occasion de pratiquer le base-ball, l’aviron et la gymnastique. En 1878, nous y faisions allusion au paragraphe précédent, J.Kano créa le Kasei Base Ball Club, autrement dit le premier club professionnel du Japon. Il n’a que 18 ans. Il est très doué pour le ju-jutsu et fait l’honneur de son école. On rapporte qu’au cours d’un combat avec un élève très fort de 75 kg, - soit 27 kg de plus que lui - , nommé Kenkichi Fukushima, Kano le projeta avec un mouvement que personne jusqu’alors ne connaissait : se plaçant sous Fukushima, Kano passa son bras gauche contre la cuisse gauche de son adversaire par l’intérieur, tout en le tirant au-dessus de lui avec son bras droit. Il le fit ainsi rouler autour de ses épaules et basculer sur le côté. Kano venait d’inventer Kata-guruma. Ce combat amena une confirmation supplémentaire pour Kano : le plus agile pouvait triompher du plus fort. Ainsi redoubla-t-il d’efforts, s’entraînant plusieurs fois par jour jusqu’à très tard le soir. C’est de cet acharnement que lui valut le sobriquet, devenu célèbre, de « Kano mankinko » (Mankinko signifie pansement). Comme nous allons le voir, l’explication de ce surnom n’est pas sans intérêt. En effet, à cette époque, le vêtement utilisé pour la pratique du ju-jutsu n’est pas encore le judogi mais le « keikogi », qui avait des manches s’arrêtant au-dessus des coudes et des culottes courtes coupées à mi-cuisse. De ce fait, Kano avait en permanence des ecchymoses et des brûlures aux coudes, aux genoux, aux jambes et aux pieds, qu’il soignait avec un pansement approprié, le mankinko. Excédé par ses blessures à répétition et inexorables, Kano en vînt à modifier le keikogi afin qu’il protège mieux le corps, et créa ainsi le judogi tel que nous le connaissons actuellement.

L’année suivante, en 1879, maître Fukada décède à l’âge de 52 ans. Selon la tradition, c’est au meilleur disciple de l’école, J. Kano, qu’est revenu l’honneur de recevoir en héritage tous les livres et documents du senseï. Dans une lettre testament, maître Fukada nomme J. Kano « menkyo kaiden », c’est à dire qu’il lui octroie le droit d’enseigner. Kano poursuivra son propre apprentissage dans la même école auprès de Masatomo Iso, le fils adoptif de Iso Mataemon, jusqu’en 1881 et la mort de ce dernier. J.Kano se perfectionnera encore un an sous la houlette du sensei Tsunetoshi Likubu. Et durant toute cette période, il établira une véritable fusion des anciennes techniques du ju-jutsu, qu’il modifiera plus ou moins à la lumière de ses observations et de ses premières expériences. Autrement dit, Kano effectua un véritable travail d’analyse, de réflexion et finalement d’accoucheur, de maïeuticien, en élaborant non seulement une synthèse personnelle du vieux ju-jutsu, mais aussi, et peut être surtout, en réalisant que le nouveau judo pouvait s’avérer être bien plus qu’un simple combat physique, aussi technique soit-il, et devenir une véritable méthode d’éducation intellectuelle. Plus précisément, la caractéristique même du judo élaboré par Kano est de prendre prétexte de la confrontation physique pour permettre un réel examen sur soi et une méthode de vie basée entièrement sur la souplesse. Ainsi ce principe de portée générale, la meilleure utilisation de l’énergie physique et mentale ( « Seiryoku Zen Yo »), englobe-t-il, en fait, toutes les activités humaines. C’est pourquoi le judo correspond à une étude, à un procédé d’entraînement applicable à l’esprit et au corps aussi bien en ce qui concerne la direction de sa vie privée que la direction de sa vie professionnelle. Selon J.Kano, d’autres moyens peuvent être utilisés pour cultiver ce principe, mais il précisait aussi que s’il avait choisit le judo, c’est parce qu’il permettait dans le même temps de rendre le corps de ses élèves sain, fort et utile.
Mais revenons à ce mois de février de l’hiver 1882 où Kano créa le judo du Kodokan (judo de « l’institut du Grand Principe). Il n’avait pas encore fêté ses vingt-deux printemps lorsqu’il ouvrit son premier dojo dans le modeste temple bouddhique d’Eisho-ji, dans la banlieue de Tokyo, sur une surface de douze tatamis, soit environ vingt mètres carrés. Le nouveau judo qu’il proposait était débarrassé de l’esprit féodal des vieilles écoles de Ju-Jutsu. Il s’accompagnait d’un système d’entraînement innovant, basé principalement sur la souplesse, le déséquilibre et l’art de la chute, (ukémi), mais surtout sur la réflexion. De plus, les techniques d’atemi-waza (coups portés), jugées peu en rapport avec la philosophie développée par Kano, furent bannies de son enseignement. Nous l’avons vu avec l’étymologie du terme « ju-do », c’est à un véritable parricide auquel nous avons à faire. On peut avoir peine, de nos jours, à prendre la pleine mesure du culot et de l’audace dont à fait preuve J.Kano lorsqu’il décida d’ouvrir cette école, sans aucun lien avec les écoles traditionnelles et sans aucun soutien officiel. On l’imagine aisément, petit homme vigoureux sous le froid hivernal, accrochant plein d’espoir et de malice la pancarte calligraphiée « Kodokan » sur l’un des murs du petit temple bouddhique, puis attendre sereinement que se présente son premier disciple en regardant la neige tomber. Mais laissons là l’imagination pour retrouver les faits. Le premier élève à bénéficier de son enseignement se nommait Tomita Tsunejiro et il s’inscrivit le 5 juin 1882, soit à peu près quatre mois après l’ouverture du Kodokan. Kano avait eu raison de ne pas renoncer. Deux mois plus tard, en août 1882, le Kodokan comptera six élèves lorsque Shiro Saïgo le fameux « Sugata Sanshiro » mis en scène par A. Kurosawa dans le film qui nous intéresse, vînt à son tour s’y inscrire. Il deviendra le meilleur élève de maître Kano. Arrêtons-nous un instant sur cette nouvelle grande figure du nouveau judo qu’est Shiro Saïgo. Adapté du roman éponyme de l’écrivain Tsuneo Tomita, qui retrace l’avènement du judo et les premiers exploits de J.Kano et de son jeune disciple Shiro Saigo, rebaptisés Shogoro Yano et Sugata Sanshiro pour les besoins de la fiction, le film de Kurosawa impose d'emblée le réalisateur comme un génie du septième art; par exemple, La Légende du Grand Judo innaugure dans l'histoire du cinéma la technique du ralenti dans les films de combats, ce qui n'est pas rien. Pour l’anecdote, Tsuneo Tomita, l’auteur, était le fils de Tomita Tsunnejiro, qui fut lui-même le tout premier disciple de J.Kano, ce qui tend à garantir une certaine véracité de l’histoire rapportée. Notons en outre que dés la parution du roman, en 1942, A.Kurosawa, à l’époque jeune cinéaste aux dents longues, s’est battu avec beaucoup d’ardeur pour en obtenir les droits. Il transposera l’œuvre à l’écran deux fois en tant que réalisateur : en 1943 avec « La Légende du grand Judo », et en 1945 avec « Zoku Sugata Sanshiro », puis une troisième fois encore en 1965 en qualité de post-producteur avec « Sugata Sanshiro », synthèse des deux précédentes adaptations. Pour finir, signalons que d’innombrables versions du roman « Sugata Sanshiro » furent transposées à l’écran par une flopée de réalisateurs japonais, mettant ainsi en évidence l’une des caractéristiques les plus typiques du cinéma nippon d’après-guerre, à savoir son besoin délirant de reproduire différentes versions d’un même mythe.

Les historiens et chroniqueurs du judo s’accordent à dire que Shiro Saïgo (Sugata Sanshiro) est né en 1866 dans l’ancien fief d’Aizu. Il n’était donc que de seulement six ans le cadet de J.Kano. Nous ne savons pas grand chose de sa prime jeunesse. Nous le retrouvons à l’âge de quinze ans, en août 1882, à Tokyo où il s’inscrit au Kodokan. Très rapidement, le jeune élève s’avère extrêmement doué naturellement. Sa compréhension de ce nouvel art est instinctive. Sa petite morphologie (il ne fut mesurer qu’à 1,55m pour environ 55 kg) et son centre de gravité très bas s’adaptant idéalement à la discipline. Il possédait, comme on dit, une forme de corps parfaite lors de l’exécution des mouvements. Il fut d’ailleurs le seul à son époque à maîtriser la technique yama-arashi (« tempête dans la montagne »), sorte de hanche balayée très haut qu’il pratiquait à gauche. Dés son arrivée au Kodokan, on le surnomma « le chat » pour sa faculté extraordinaire à se retourner dans l’espace afin d’éviter la chute et se réceptionner sur les pieds ou sur le ventre. Il est certainement à ce titre l’inventeur de « la chute spatiale », couramment utilisée de nos jours, qui consiste en ce que Uke fasse une volte-face et se réceptionne sur les mains à la manière d’une « pompe » lorsque Tori l’attaque sur un mouvement arrière. Outre cette pléthore de talents, la rumeur, et nous pensons qu’elle est fondée, prête à Shiro Saïgo un goût certain pour le saké ainsi qu’une relative accoutumance à son égard. Quoiqu’il en soit, en août 1883, soit un an après son arrivée sous la tutelle de J.Kano, Shiro Saïgo devient, en compagnie de Tsunejiro Tomita, le premier 1er dan de Judo. Il deviendra 2èm dan au mois de novembre de la même année. En août 1885, il est nommé 4èm dan sans avoir à passer le 3èm dan, et obtiendra le 5èm dan en janvier 1889, après environ sept années d’initiation. Avant même cette date, il était déjà devenu une légende. Figure emblématique et chef de file du Kodokan, il avait dû livrer de nombreux combats revanchards contre différentes écoles de Ju-Jutsu, afin de sauvegarder l’honneur et le statut du judo, (il s’agit toujours de survivre et de durer), et il avait toujours triomphé. Rappeler qu’à cette époque, le système des catégories de poids n’était pas encore inventé permet de mieux mesurer l’ampleur de l’exploit réalisé par Shiro Saïgo en restant invaincu, comme de comprendre l’énorme popularité dont il bénéficiait. Imaginez donc ce que pouvait être le contraste des gabarits lorsque les deux combattants se retrouvaient face à face pour se saluer, - Shiro Saïgo ne pesant jamais plus de 55 kg -, et que sous les yeux d’un public médusé était réactualisé le mythe de David et Goliath. Un passage du film rend compte de cette popularité lorsque Kurosawa fait entendre par la bouche des enfants du village une chanson en l'honneur de Sugata, ce qui est un fait authentique. De septembre 1889 à janvier 1891, Jigoro Kano va s’absenter pendant 14 mois pour un voyage en Europe. Il décidera alors de confier les clefs du Kodokan à son meilleur disciple. Seulement, en mai 1890, Shiro Saïgo déserte « l’Institut du Grand Principe ». Nous aurions ici aimé écrire la suite d’un grand et singulier destin, jonché d’honneurs et d’intrépidité, mais il n’en est rien. Nous savons simplement de Shiro Saïgo qu’il fut, plus tard, sous-directeur d’un journal basé à Nagasaki. Il décédera en 1922 à l’âge de 57 ans. J.Kano lui remettra le 6èm dan à titre posthume et dira de lui dans l’épitaphe qu’il rédigea : « Sa compréhension des techniques reste incomparable. Personne, parmi les millions de pratiquants qui suivirent sa voie, ne parvînt à surpasser la maîtrise de Shiro Saïgo. » (Extrait de l’Epitaphe écrite par Jigoro Kano).
Reprenons le fil de notre histoire. Nous sommes en 1883 et le Kodokan de Kano a à peine un an d’existence. Dans l’étroit dojo, la violence des chutes de la petite dizaine d’élèves qui s’exerce sur les tatamis soumet à la torture la solidité des fondations du vieux bâtiment. Rapidement, il fallut construire un autre dojo, à l’extérieur cette fois-ci. C’est M. Tatsura, alors sous-secrétaire au ministère de la guerre, qui aida J. Kano à louer une maison qui appartenait à l’armée, dans la rue Masogo, où fut installé le dojo. Trois ans plus tard, en 1886, les dix élèves sont devenus cent et le Kodokan dut ainsi déménager plusieurs fois. En 1888, grâce à la ténacité de Kano, la première démonstration officielle de judo eut lieu au Kodokan en présence de M. Enomoto, ministre de l’éducation, et d’illustres personnalités japonaises et étrangères furent alors convaincues des qualités éducatives et pédagogiques du judo. En 1889, l’Institut comptera 600 élèves. (En l’espace de sept années, le dojo était passé de 12 tatamis initiaux à 167 tatamis). C’est précisément durant cette période, de 1886 à 1889, que la suprématie du judo allait définitivement s’établir à Tokyo. Il faut dire qu’en marge de fréquents défis, le grand tournoi opposant les représentants du nouveau Judo à des combattants sélectionnés par le Yoshin-ryu-ju-jutsu y fut pour beaucoup, puisqu’il vît l’écrasante et symbolique victoire des partenaires de Shiro Saïgo. Le séculaire Ju-Jutsu était dépassé. Une nouvelle époque allait naître.
link Etoile Blog














































































































































































 Afin d’aider la jeune et jolie fleuriste aveugle dont il vient de tomber
amoureux, Charlot tente, en se lançant dans la boxe, de gagner l'argent nécessaire pour que la jeune femme se fasse opérer et recouvre la vue. C’est beau, hein ? City Lights et
Les Temps Modernes (1936) constituent les deux
Afin d’aider la jeune et jolie fleuriste aveugle dont il vient de tomber
amoureux, Charlot tente, en se lançant dans la boxe, de gagner l'argent nécessaire pour que la jeune femme se fasse opérer et recouvre la vue. C’est beau, hein ? City Lights et
Les Temps Modernes (1936) constituent les deux 


 L’histoire, très classique aujourd’hui mais assez neuve à l’époque, de Midge Kelly (Kirk Douglas), un gars qui utilise ses poings pour
sortir de la misère. Séduit par les encouragements de la foule, l'argent et le papillonnement de jolies blondes autour de lui, Midge devient peu à peu le héros du public mais une crapule dans sa
vie privée. Egocentrique, orgueilleux et dur, il décède d’une attaque cérébrale après être devenu champion du monde. Splendeur et décadence, véritable tragédie, le ton du film est plutôt
désespéré.
L’histoire, très classique aujourd’hui mais assez neuve à l’époque, de Midge Kelly (Kirk Douglas), un gars qui utilise ses poings pour
sortir de la misère. Séduit par les encouragements de la foule, l'argent et le papillonnement de jolies blondes autour de lui, Midge devient peu à peu le héros du public mais une crapule dans sa
vie privée. Egocentrique, orgueilleux et dur, il décède d’une attaque cérébrale après être devenu champion du monde. Splendeur et décadence, véritable tragédie, le ton du film est plutôt
désespéré. Killer’s Kiss, deuxième
long-métrage de S. Kubrick (petit budget, d’où les 67 minutes), raconte l’histoire de Davy Gordon, boxeur miteux, qui se retrouve aux prises avec un parrain de la mafia pour lui reprendre
coûte que coûte la femme qu'il aime... Quand le film de boxe sert de prétexte au thriller. A mon humble avis, ce n’est pas le meilleur Kubrick loin de là, mais la scène de combat dans l'usine à
mannequin est assez mémorable. A bien y regarder, ce film contenait déjà en germes certaines thématiques et de nombreuses qualités techniques qui marqueront la filmographie du maître.
Killer’s Kiss, deuxième
long-métrage de S. Kubrick (petit budget, d’où les 67 minutes), raconte l’histoire de Davy Gordon, boxeur miteux, qui se retrouve aux prises avec un parrain de la mafia pour lui reprendre
coûte que coûte la femme qu'il aime... Quand le film de boxe sert de prétexte au thriller. A mon humble avis, ce n’est pas le meilleur Kubrick loin de là, mais la scène de combat dans l'usine à
mannequin est assez mémorable. A bien y regarder, ce film contenait déjà en germes certaines thématiques et de nombreuses qualités techniques qui marqueront la filmographie du maître.
 Ce film est globalement inspiré de la vie du boxeur italien Primo Carnera qui connut la « malchance » de voir une bonne partie
des gains amassés lors de sa carrière être récupérée par son manager corrompu. Lorsque Carnera arrêta sa carrière, il était ruiné. (Il tenta par la suite de se reconvertir dans le métier
d’acteur). Le réalisateur Mark Robson, qui décidemment aimait beaucoup la boxe – Cf Le Champion – remet le couvert et nous donne donc à voir l'histoire de Toto Moreno, poids lourd
argentin assez quelconque sur le ring, victime du système corrompu du monde de la boxe. Au passage, du grand Humphrey Bogart en journaliste sportif peu scrupuleux.
Ce film est globalement inspiré de la vie du boxeur italien Primo Carnera qui connut la « malchance » de voir une bonne partie
des gains amassés lors de sa carrière être récupérée par son manager corrompu. Lorsque Carnera arrêta sa carrière, il était ruiné. (Il tenta par la suite de se reconvertir dans le métier
d’acteur). Le réalisateur Mark Robson, qui décidemment aimait beaucoup la boxe – Cf Le Champion – remet le couvert et nous donne donc à voir l'histoire de Toto Moreno, poids lourd
argentin assez quelconque sur le ring, victime du système corrompu du monde de la boxe. Au passage, du grand Humphrey Bogart en journaliste sportif peu scrupuleux.
 Requiem for a
Heavyweight est l’adaptation cinématographique et éponyme du téléfilm à succès des années 60 dans lequel l'immense Jack Palance jouait le rôle de Harlan "Mountain" McClintock. Ce rôle dans
la version de R. Nelson, se verra confié à Anthony Quinn, tout aussi immense.
Requiem for a
Heavyweight est l’adaptation cinématographique et éponyme du téléfilm à succès des années 60 dans lequel l'immense Jack Palance jouait le rôle de Harlan "Mountain" McClintock. Ce rôle dans
la version de R. Nelson, se verra confié à Anthony Quinn, tout aussi immense.  Quelque part en Californie, Billy Tully est un ancien boxeur devenu alcoolique après la
mort de sa femme. Aidé d’un de ses amis,
Quelque part en Californie, Billy Tully est un ancien boxeur devenu alcoolique après la
mort de sa femme. Aidé d’un de ses amis,  Adriaaaaaaannnnn !!! Attention, on touche ici à la
série de mon enfance. Après avoir regardé un Rocky (mais ça marchait aussi avec un Bruce Lee), impossible de ne pas se bastonner un peu avec les potes. Je ne sais pas combien de fois
j’ai pu les re-voir et saigner du nez. Bref, affirmer que le 1er Rocky est le meilleur de la série est une lapalissade mais je le dis quand même. Ce film a définitivement posé les
jalons du film de boxe et servira pendant de nombreuses années d’étalon (italien) en la matière. On précisera tout de suite que le personnage de Rocky est directement inspiré de
Adriaaaaaaannnnn !!! Attention, on touche ici à la
série de mon enfance. Après avoir regardé un Rocky (mais ça marchait aussi avec un Bruce Lee), impossible de ne pas se bastonner un peu avec les potes. Je ne sais pas combien de fois
j’ai pu les re-voir et saigner du nez. Bref, affirmer que le 1er Rocky est le meilleur de la série est une lapalissade mais je le dis quand même. Ce film a définitivement posé les
jalons du film de boxe et servira pendant de nombreuses années d’étalon (italien) en la matière. On précisera tout de suite que le personnage de Rocky est directement inspiré de  On prend les mêmes et on recommence.
Rocky est l’un des tout premiers films dont le succès commercial fut tel qu’il engendra une suite plus ou moins clonesque. Il faut le dire, techniquement parlant, Rocky est mauvais boxeur. A part
un cœur gros comme ça et un mental de kamikaze, son jeu de jambes et ses déplacements sont risibles, sa garde fantomatique, ses coups prévisibles et dangereux pour lui-même (les blessures
musculaires les plus fréquentes en boxe proviennent de coups lâchés dans le vide) et ses esquives sont… euh, non pardon…, Rocky n’esquive pas. Il fonce tête baissée, aux antipodes de ce qui est
enseigné dans les écoles de boxe. On n’est pas loin là d’un certain mépris pour le spectateur dans les coups portés et dans l’exhibition. Bref, un kangourou borgne pourrait l’exploser. Pourtant,
dans Rocky et Rocky II, la magie pour moi opère bel et bien, même si les dernières secondes du combat final sont un peu capilotractées.
On prend les mêmes et on recommence.
Rocky est l’un des tout premiers films dont le succès commercial fut tel qu’il engendra une suite plus ou moins clonesque. Il faut le dire, techniquement parlant, Rocky est mauvais boxeur. A part
un cœur gros comme ça et un mental de kamikaze, son jeu de jambes et ses déplacements sont risibles, sa garde fantomatique, ses coups prévisibles et dangereux pour lui-même (les blessures
musculaires les plus fréquentes en boxe proviennent de coups lâchés dans le vide) et ses esquives sont… euh, non pardon…, Rocky n’esquive pas. Il fonce tête baissée, aux antipodes de ce qui est
enseigné dans les écoles de boxe. On n’est pas loin là d’un certain mépris pour le spectateur dans les coups portés et dans l’exhibition. Bref, un kangourou borgne pourrait l’exploser. Pourtant,
dans Rocky et Rocky II, la magie pour moi opère bel et bien, même si les dernières secondes du combat final sont un peu capilotractées.
 Bienvenue à nanar-land. Ce film me colle le bourdon tant il est mauvais.
D’ordinaire, les nanars, on les regarde au second degré en se marrant, mais là ça ne marche pas. Pensez donc, Barbara Streisand (parfumeuse devenue manager) vs Ryan O’Neal (boxeur qui refuse de
prendre des coups par peur d’abîmer sa belle gueule) moulés l’un et l’autre dans des combis totalement surréalistes de couleur mauve (me rappellent Jesus, le joueur de Bowling de The Big
Lebowski). On est ici plus proche de la série Fame que du film de boxe. Tout ça pour narrer une histoire d’ « amour vache ». Le scénario n’est pas crédible, les
acteurs sont nuls, les dialogues idiots, la photo pourrie, même l’affiche est à débagouler.
Bienvenue à nanar-land. Ce film me colle le bourdon tant il est mauvais.
D’ordinaire, les nanars, on les regarde au second degré en se marrant, mais là ça ne marche pas. Pensez donc, Barbara Streisand (parfumeuse devenue manager) vs Ryan O’Neal (boxeur qui refuse de
prendre des coups par peur d’abîmer sa belle gueule) moulés l’un et l’autre dans des combis totalement surréalistes de couleur mauve (me rappellent Jesus, le joueur de Bowling de The Big
Lebowski). On est ici plus proche de la série Fame que du film de boxe. Tout ça pour narrer une histoire d’ « amour vache ». Le scénario n’est pas crédible, les
acteurs sont nuls, les dialogues idiots, la photo pourrie, même l’affiche est à débagouler.
 ATTENTION, PUR CHEF D’OEUVRE !!!
ATTENTION, PUR CHEF D’OEUVRE !!!
 « Il t’est arrivé ce
qui peut arriver de pire à un boxeur : tu t’es embourgeoisé. » Bon, Rocky se la coulait douce mais il doit se remettre en question parce que Clubber Lang Barracuda (Mister T) est
furax et veut lui ravir le titre. Qui plus est, Clubber Lang est plus ou moins responsable de la mort de Mickey, le vieux et fidèle coach de l’étalon italien. C’est donc son ancien adversaire
Apollo, désormais un ami de la famille Balboa, qui tiendra le rôle d’entraîneur. Ici, c’est l’honneur du champion qui est en jeu, ainsi qu’un parfum de vengeance que l’on retrouvera dans
l’épisode suivant. L’œil du tigre mec ! On soulignera que d’un Rocky à l’autre, la musculature du héros se transforme entièrement. Plutôt molle dans le premier film, sa musculature
dés le troisième volet est celle d’un professionnel acharné du body-building. Or, de manière peut-être pas systématique mais assez générale, ce type de morphologie musculaire est
déconseillé chez les boxeurs. Les muscles serrés, épais, tassés sur eux-mêmes ne possèdent aucune souplesse et se tétanisent très vite et durablement, les jambes se fatiguent également beaucoup
plus vite.
« Il t’est arrivé ce
qui peut arriver de pire à un boxeur : tu t’es embourgeoisé. » Bon, Rocky se la coulait douce mais il doit se remettre en question parce que Clubber Lang Barracuda (Mister T) est
furax et veut lui ravir le titre. Qui plus est, Clubber Lang est plus ou moins responsable de la mort de Mickey, le vieux et fidèle coach de l’étalon italien. C’est donc son ancien adversaire
Apollo, désormais un ami de la famille Balboa, qui tiendra le rôle d’entraîneur. Ici, c’est l’honneur du champion qui est en jeu, ainsi qu’un parfum de vengeance que l’on retrouvera dans
l’épisode suivant. L’œil du tigre mec ! On soulignera que d’un Rocky à l’autre, la musculature du héros se transforme entièrement. Plutôt molle dans le premier film, sa musculature
dés le troisième volet est celle d’un professionnel acharné du body-building. Or, de manière peut-être pas systématique mais assez générale, ce type de morphologie musculaire est
déconseillé chez les boxeurs. Les muscles serrés, épais, tassés sur eux-mêmes ne possèdent aucune souplesse et se tétanisent très vite et durablement, les jambes se fatiguent également beaucoup
plus vite.
 A l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, dans une Allemagne vivant
sous le régime nazi d’Hitler, Joe Cavalier (ça doit être cool de s’appeler ainsi), entraineur de l'équipe française de boxe, se rend en train dans la capitale accompagné de ses "poulains".
Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans, Karl, un petit juif, poursuivi par la Gestapo.
A l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, dans une Allemagne vivant
sous le régime nazi d’Hitler, Joe Cavalier (ça doit être cool de s’appeler ainsi), entraineur de l'équipe française de boxe, se rend en train dans la capitale accompagné de ses "poulains".
Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans, Karl, un petit juif, poursuivi par la Gestapo.  Sur un plan historico-politique, en plein cœur de la guerre froide, ce film est un pur produit de propagande US qui met en exergue la belle morale
ricaine. Ivan Drago, colosse russe à la puissance démesurée, porte un coup fatal à Apollo Creed, le pote de Rocky, lors d’un match exhibition. Une nouvelle fois, l’étalon italien doit faire face
à la mort d’un proche et le venger. Considéré aujourd’hui comme un nanar intégral, il a pour moi une valeur sentimentale proche de celle que j’accorde aux vieux T-shirt élimés que je porte pour
dormir. USA vs URSS, bloc ouest vs bloc est. Ce n’est plus seulement l’honneur de l’homme ou du champion qui est en jeu mais l’honneur de la nation toute entière. Ainsi le drapeau américain
est-il omniprésent, James Brown en fait des tonnes sur Living in America, les camarades Popov sont très méchants, z’ont tué Appolo et se prétendent les meilleurs (un plan rapide montre
Ivan Drago recevoir une injection, idée subliminale d’un dopage aux stéroïdes). Bref, Rocky et
Sur un plan historico-politique, en plein cœur de la guerre froide, ce film est un pur produit de propagande US qui met en exergue la belle morale
ricaine. Ivan Drago, colosse russe à la puissance démesurée, porte un coup fatal à Apollo Creed, le pote de Rocky, lors d’un match exhibition. Une nouvelle fois, l’étalon italien doit faire face
à la mort d’un proche et le venger. Considéré aujourd’hui comme un nanar intégral, il a pour moi une valeur sentimentale proche de celle que j’accorde aux vieux T-shirt élimés que je porte pour
dormir. USA vs URSS, bloc ouest vs bloc est. Ce n’est plus seulement l’honneur de l’homme ou du champion qui est en jeu mais l’honneur de la nation toute entière. Ainsi le drapeau américain
est-il omniprésent, James Brown en fait des tonnes sur Living in America, les camarades Popov sont très méchants, z’ont tué Appolo et se prétendent les meilleurs (un plan rapide montre
Ivan Drago recevoir une injection, idée subliminale d’un dopage aux stéroïdes). Bref, Rocky et L’histoire d’un boxeur rincé, Johnny Walker (Mickey Rourke), qui a multiplié les combats sur le ring et détruit sa santé sans jamais
connaître la gloire. Réfugié dans une station balnéaire, l’amour s’offre à lui sous les traits d’une femme nommée Ruby tandis qu’il se lie d’une profonde amitié avec un petit truand, Wesley
Pendergrass (Christopher Walken, génialissime comme toujours) avec lequel il se lance dans la cambriole. Rapidement, Walker va devoir choisir entre l’amour qu’il porte à Ruby et son amitié avec
Wesley. Et bien figurez-vous que ce n’est pas le si mauvais film que l’on pourrait croire, c’est clair que ça manque de rythme, mais l’univers des loosers est bien restitué et les acteurs sonnent
justes. Musique d’Eric Clapton.
L’histoire d’un boxeur rincé, Johnny Walker (Mickey Rourke), qui a multiplié les combats sur le ring et détruit sa santé sans jamais
connaître la gloire. Réfugié dans une station balnéaire, l’amour s’offre à lui sous les traits d’une femme nommée Ruby tandis qu’il se lie d’une profonde amitié avec un petit truand, Wesley
Pendergrass (Christopher Walken, génialissime comme toujours) avec lequel il se lance dans la cambriole. Rapidement, Walker va devoir choisir entre l’amour qu’il porte à Ruby et son amitié avec
Wesley. Et bien figurez-vous que ce n’est pas le si mauvais film que l’on pourrait croire, c’est clair que ça manque de rythme, mais l’univers des loosers est bien restitué et les acteurs sonnent
justes. Musique d’Eric Clapton.
 Après vous être coltiné des combats dantesques contre Appolo
Creed (x2), Clubber Lang et Ivan Drago, et d’autres encore moins illustres (la carrière pro de Rocky compte en tout 18 combats), c’est un peu normal si vous ne pétez pas le feu, surtout passé la
quarantaine. Et bien c’est ce qui arrive à Rocky, ce qui le pousse à prendre définitivement sa retraite. Qui plus est, malin comme il est, il se fait escroqué et se retrouve sur la paille. Obligé
de revendre tous ses biens, il se voit contraint de réintégrer le quartier de Philadelphie de ses débuts. Ayant repris l'ancien gymnase de Mickey, Rocky fait la connaissance d'un jeune
boxeur prometteur, Tommy Gunn. Devenu son entraîneur et ami, Rocky conduit Tommy au sommet du classement mondial. Mais celui-ci finit par se retourner contre Rocky, et rejoint le promoteur George
Washington Duke, avatar du fameux Don King, au moment même où décolle sa carrière. Le film est loin d’être exceptionnel, certes, mais il a le mérite d’essayer de renouveler la série tout en
revenant aux origines sociales du héros.
Après vous être coltiné des combats dantesques contre Appolo
Creed (x2), Clubber Lang et Ivan Drago, et d’autres encore moins illustres (la carrière pro de Rocky compte en tout 18 combats), c’est un peu normal si vous ne pétez pas le feu, surtout passé la
quarantaine. Et bien c’est ce qui arrive à Rocky, ce qui le pousse à prendre définitivement sa retraite. Qui plus est, malin comme il est, il se fait escroqué et se retrouve sur la paille. Obligé
de revendre tous ses biens, il se voit contraint de réintégrer le quartier de Philadelphie de ses débuts. Ayant repris l'ancien gymnase de Mickey, Rocky fait la connaissance d'un jeune
boxeur prometteur, Tommy Gunn. Devenu son entraîneur et ami, Rocky conduit Tommy au sommet du classement mondial. Mais celui-ci finit par se retourner contre Rocky, et rejoint le promoteur George
Washington Duke, avatar du fameux Don King, au moment même où décolle sa carrière. Le film est loin d’être exceptionnel, certes, mais il a le mérite d’essayer de renouveler la série tout en
revenant aux origines sociales du héros.
 Les destins parallèles de deux jeunes garçons que la boxe réunit. Pour l’un, Shinji, la boxe est curative et se révèle être un excellent
catalyseur de divers pulsions qui
Les destins parallèles de deux jeunes garçons que la boxe réunit. Pour l’un, Shinji, la boxe est curative et se révèle être un excellent
catalyseur de divers pulsions qui Tenez-vous bien, le plan-séquence d’ouverture du championnat du monde des poids lourds qui se tient au casino d’Atlantic City ne dure pas
moins de 10 minutes, caméra à l’épaule. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est parfaitement maîtrisé. Au point que c’est largement le meilleur passage du film. De nombreuses choses
sont dites sur la boxe durant ces dix minutes (concentration du boxeur, tensions du ring, paris en tous genres, corruptions, match truqué…) et dans le même temps, tous les protagonistes de
l’intrigue sont présentés. Un crime est commis durant le combat. Nicolas Cage ferme les portes du casino : l’assassin est dans la place. Du grand art.
Tenez-vous bien, le plan-séquence d’ouverture du championnat du monde des poids lourds qui se tient au casino d’Atlantic City ne dure pas
moins de 10 minutes, caméra à l’épaule. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est parfaitement maîtrisé. Au point que c’est largement le meilleur passage du film. De nombreuses choses
sont dites sur la boxe durant ces dix minutes (concentration du boxeur, tensions du ring, paris en tous genres, corruptions, match truqué…) et dans le même temps, tous les protagonistes de
l’intrigue sont présentés. Un crime est commis durant le combat. Nicolas Cage ferme les portes du casino : l’assassin est dans la place. Du grand art.
 La véritable histoire du poids moyens américain Rubin "Hurricane" Carter, injustement condamné à perpétuité pour un triple meurtre qu’il
n’a pas commis, interprété par un Denzel Washington plutôt inspiré, d’ailleurs récompensé par un Golden Globe pour sa prestation. L’affaire fit à l’époque, en 1967, beaucoup de bruit et de
nombreux artistes et intellectuels prirent cause pour Hurricane, on se rappellera notamment la célèbre protest-song de Bob Dylan (« Hurricane »). Il fallut
pourtant attendre 1988 pour qu’un non-lieu soit accordé. L'affaire Rubin Carter aura duré 22 ans. Sur fond de racisme blanc vs noir, le film est aussi riche que percutant ; et si les scènes
de boxe (certaines en noir et blanc) ne sont pas pléthoriques, elles ont le mérite d’être esthétiques et soignées.
La véritable histoire du poids moyens américain Rubin "Hurricane" Carter, injustement condamné à perpétuité pour un triple meurtre qu’il
n’a pas commis, interprété par un Denzel Washington plutôt inspiré, d’ailleurs récompensé par un Golden Globe pour sa prestation. L’affaire fit à l’époque, en 1967, beaucoup de bruit et de
nombreux artistes et intellectuels prirent cause pour Hurricane, on se rappellera notamment la célèbre protest-song de Bob Dylan (« Hurricane »). Il fallut
pourtant attendre 1988 pour qu’un non-lieu soit accordé. L'affaire Rubin Carter aura duré 22 ans. Sur fond de racisme blanc vs noir, le film est aussi riche que percutant ; et si les scènes
de boxe (certaines en noir et blanc) ne sont pas pléthoriques, elles ont le mérite d’être esthétiques et soignées.
 Biopic de la carrière de Cassius Clay à partir de sa victoire historique sur le champion du monde Sonny Liston en 1964
jusqu'au célèbre combat de Kinshasa contre George Foreman en 1974. En marge de sa carrière sportive de l'époque, le métrage retrace l'engagement de celui qui changera de nom pour
Mohamed Ali aux côtés du mouvement Nation of Islam et ses relations avec Malcom X.
Biopic de la carrière de Cassius Clay à partir de sa victoire historique sur le champion du monde Sonny Liston en 1964
jusqu'au célèbre combat de Kinshasa contre George Foreman en 1974. En marge de sa carrière sportive de l'époque, le métrage retrace l'engagement de celui qui changera de nom pour
Mohamed Ali aux côtés du mouvement Nation of Islam et ses relations avec Malcom X.  George Chambers, surnommé "Iceman", champion de boxe dans la catégorie poids lourds, est accusé d'un viol qu'il nie vigoureusement avoir
commis. Il n'accepte pas le fait de ne pouvoir préserver son statut de champion invaincu, au moment même où sa carrière de boxeur professionnel est à son sommet. Dans un pénitencier où il va
bientôt être transféré, Monroe Hutchen (Wesley Snipes, mouais, bof), boxeur dans la catégorie des mi-lourds, purge une peine de prison à vie pour un crime passionnel. Ce dernier se demande s'il
serait capable de faire carrière dans cette discipline sportive et de rencontrer "Iceman" au cours d'un combat... . Le film est un habile mélange de film de boxe et de film de prison mais ce
n’est certainement pas un chef-d’œuvre. A noter la bonne interprétation du regretté Peter « Colombo » Falk en vieux coach qui a de la bouteille.
George Chambers, surnommé "Iceman", champion de boxe dans la catégorie poids lourds, est accusé d'un viol qu'il nie vigoureusement avoir
commis. Il n'accepte pas le fait de ne pouvoir préserver son statut de champion invaincu, au moment même où sa carrière de boxeur professionnel est à son sommet. Dans un pénitencier où il va
bientôt être transféré, Monroe Hutchen (Wesley Snipes, mouais, bof), boxeur dans la catégorie des mi-lourds, purge une peine de prison à vie pour un crime passionnel. Ce dernier se demande s'il
serait capable de faire carrière dans cette discipline sportive et de rencontrer "Iceman" au cours d'un combat... . Le film est un habile mélange de film de boxe et de film de prison mais ce
n’est certainement pas un chef-d’œuvre. A noter la bonne interprétation du regretté Peter « Colombo » Falk en vieux coach qui a de la bouteille.
 Autrefois entraîneur de boxe réputé, Frankie (Clint Eastwood) dirige une petite salle de boxe régionale avec son meilleur ami,
un ancien boxeur nommé Scrap (Morgan Freeman). Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d'une serveuse solitaire de 32 ans nommée Maggie Fitzgerald (Hilary Swank). Frankie est réservé quant à
l'idée de devenir son entraîneur, mais il finit par accepter de la prendre en charge. Une relation mouvementée, sorte d’histoire d’amour platonique, se noue entre eux. Jusqu’à ce qu’un
drame surgisse… Bon, la presse est à peu prés unanime, il s’agirait d’un excellent film, voire d’un chef-d’œuvre. De mon côté, ce n’est pas exactement la même limonade. Ok, c’est relativement
bien interprété. Néanmoins, j’ai trouvé le film excessivement englué dans le pathos et le mélo plan-plan et hypertrophié. On y retrouve toute les belles valeurs morales très tranchées de Clint
qui en font un bon grand-père de famille en charentaises, son idéal héroïque et manichéen du cinéma classique, sa quasi-religiosité à l’égard des symboles omniprésents, l’arthrose de ses plans,
le manque de rythme et l’accumulation de clichés guimauves, et d’autres, mais en insistant, j’ai bien peur de perdre 95% de mes lecteurs dans cette critique. Reste la boxe vous me direz. Ben non,
désolé, elle n’est que le prétexte pour nous faire pleurer.
Autrefois entraîneur de boxe réputé, Frankie (Clint Eastwood) dirige une petite salle de boxe régionale avec son meilleur ami,
un ancien boxeur nommé Scrap (Morgan Freeman). Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d'une serveuse solitaire de 32 ans nommée Maggie Fitzgerald (Hilary Swank). Frankie est réservé quant à
l'idée de devenir son entraîneur, mais il finit par accepter de la prendre en charge. Une relation mouvementée, sorte d’histoire d’amour platonique, se noue entre eux. Jusqu’à ce qu’un
drame surgisse… Bon, la presse est à peu prés unanime, il s’agirait d’un excellent film, voire d’un chef-d’œuvre. De mon côté, ce n’est pas exactement la même limonade. Ok, c’est relativement
bien interprété. Néanmoins, j’ai trouvé le film excessivement englué dans le pathos et le mélo plan-plan et hypertrophié. On y retrouve toute les belles valeurs morales très tranchées de Clint
qui en font un bon grand-père de famille en charentaises, son idéal héroïque et manichéen du cinéma classique, sa quasi-religiosité à l’égard des symboles omniprésents, l’arthrose de ses plans,
le manque de rythme et l’accumulation de clichés guimauves, et d’autres, mais en insistant, j’ai bien peur de perdre 95% de mes lecteurs dans cette critique. Reste la boxe vous me direz. Ben non,
désolé, elle n’est que le prétexte pour nous faire pleurer.
 Rocky a définitivement raccroché les gants. Il vit
dans le quartier populaire de son enfance, où il tient désormais un restaurant décoré de tous ses anciens titres de champion et dans lequel il tient compagnie à ses clients qu’il distrait de ses
anecdotes de vieux combats. Adrian, sa femme, est morte emportée par un cancer quatre ans plus tôt et son fils, embarrassé par ce père trop caricatural, le fuit. Il ne lui reste que son
beau-frère Pollie et ses souvenirs. Mais alors que l’actuel champion de boxe, Mason Dixon (un sale type) fait fuir tous ses adversaires, le nom de Rocky-légende-vivante ressurgit dans les médias,
comme la relique d’une époque où le sport se pratiquait encore avec noblesse. Pour redonner un but à sa vie, Rocky décide de relever le gant. Est-ce une énième suite gratuite (même s’il n’y pas
de chiffre dans le titre) à but lucratif comme le sont les opus III, IV et V ? A mon humble avis, il y a un bien plus que cela.
Rocky a définitivement raccroché les gants. Il vit
dans le quartier populaire de son enfance, où il tient désormais un restaurant décoré de tous ses anciens titres de champion et dans lequel il tient compagnie à ses clients qu’il distrait de ses
anecdotes de vieux combats. Adrian, sa femme, est morte emportée par un cancer quatre ans plus tôt et son fils, embarrassé par ce père trop caricatural, le fuit. Il ne lui reste que son
beau-frère Pollie et ses souvenirs. Mais alors que l’actuel champion de boxe, Mason Dixon (un sale type) fait fuir tous ses adversaires, le nom de Rocky-légende-vivante ressurgit dans les médias,
comme la relique d’une époque où le sport se pratiquait encore avec noblesse. Pour redonner un but à sa vie, Rocky décide de relever le gant. Est-ce une énième suite gratuite (même s’il n’y pas
de chiffre dans le titre) à but lucratif comme le sont les opus III, IV et V ? A mon humble avis, il y a un bien plus que cela.  Attention, Boxe Française ! Joseph s'occupe d'un club de boxe française où il entraîne sa fille et sa nièce depuis leur enfance. Le
soir de la finale des Championnats de France, la victoire de l’une et la défaite de l’autre vont mettre en péril l’harmonie de ce trio. Entre Angie et Sandra, autrefois complices, élevées comme
deux sœurs, une dangereuse rivalité s’installer, rivalité qui dépassera les limites du ring. Comme quoi, la réalisation d’un film de boxe n’est pas l’apanage des hommes. Il faut dire que Magaly
Richard Serrano fut double championne de France de la discipline.
Attention, Boxe Française ! Joseph s'occupe d'un club de boxe française où il entraîne sa fille et sa nièce depuis leur enfance. Le
soir de la finale des Championnats de France, la victoire de l’une et la défaite de l’autre vont mettre en péril l’harmonie de ce trio. Entre Angie et Sandra, autrefois complices, élevées comme
deux sœurs, une dangereuse rivalité s’installer, rivalité qui dépassera les limites du ring. Comme quoi, la réalisation d’un film de boxe n’est pas l’apanage des hommes. Il faut dire que Magaly
Richard Serrano fut double championne de France de la discipline.
 L’histoire vraie de deux demi-frères, l’un en quête d'un second souffle et l’autre ancien toxicomane, qui, en dépit de sérieuses
tensions, vont malgré tout tenter ensemble la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur côté. Quand l’union fraternelle fait la force. Le nom du réalisateur ne vous dit peut-être pas
grand-chose pourtant, au milieu des années 90, David O. Russell était considéré comme un petit génie de la nouvelle génération, au même titre que Quentin Tarantino, David Fincher, M. Night
Shyamalan ou encore Steven Soderbergh. Pour l’heure, il n’a pas connu la même trajectoire (pouvez me donner le titre d’un autre de ses films ?), toutefois, Fighter nous montre que
son cinéma gagnerait à être au moins aussi reconnu que celui des réalisateurs que nous venons de citer. Le métrage est assez fin, plutôt équilibré et maîtrisé de bout en bout. Quant aux combats,
âpres et crispants, ils sont rendus de manière très authentique. A voir !
L’histoire vraie de deux demi-frères, l’un en quête d'un second souffle et l’autre ancien toxicomane, qui, en dépit de sérieuses
tensions, vont malgré tout tenter ensemble la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur côté. Quand l’union fraternelle fait la force. Le nom du réalisateur ne vous dit peut-être pas
grand-chose pourtant, au milieu des années 90, David O. Russell était considéré comme un petit génie de la nouvelle génération, au même titre que Quentin Tarantino, David Fincher, M. Night
Shyamalan ou encore Steven Soderbergh. Pour l’heure, il n’a pas connu la même trajectoire (pouvez me donner le titre d’un autre de ses films ?), toutefois, Fighter nous montre que
son cinéma gagnerait à être au moins aussi reconnu que celui des réalisateurs que nous venons de citer. Le métrage est assez fin, plutôt équilibré et maîtrisé de bout en bout. Quant aux combats,
âpres et crispants, ils sont rendus de manière très authentique. A voir !
 J’avoue ne pas encore être allé voir ce
film alors il m’est bien difficile d’en parler. Je vais tâcher d’y remédier rapidement.
J’avoue ne pas encore être allé voir ce
film alors il m’est bien difficile d’en parler. Je vais tâcher d’y remédier rapidement. 






 •
•
 •
• •
• •
• •
• Terminator 2 : Le jugement dernier : Le top
des effets spéciaux de l’époque et de l’action en veux-tu en voilà. On se retrouve en 1995, cette fois, les machines de Skynet,dix ans après leur échec pour éliminer Sarah Connor, envoient le
cyborg tueur T-1000 pour éliminer son fils John Connor, futur chef de la résistance humaine. Un autre robot, le T-800, est chargé de le protéger... Hasta la vista, baby…
Terminator 2 : Le jugement dernier : Le top
des effets spéciaux de l’époque et de l’action en veux-tu en voilà. On se retrouve en 1995, cette fois, les machines de Skynet,dix ans après leur échec pour éliminer Sarah Connor, envoient le
cyborg tueur T-1000 pour éliminer son fils John Connor, futur chef de la résistance humaine. Un autre robot, le T-800, est chargé de le protéger... Hasta la vista, baby…

 •
• Retour vers le futur II
Retour vers le futur II
 Une friandise pour nos zygomatiques que ce petit bijou qui voit
pénétrer l’humour au cœur de la quatrième dimension : Phil Connors, journaliste à la télévision, et accessoirement responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade
de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une
nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même
journée, celle du 2 février...
Une friandise pour nos zygomatiques que ce petit bijou qui voit
pénétrer l’humour au cœur de la quatrième dimension : Phil Connors, journaliste à la télévision, et accessoirement responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade
de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une
nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même
journée, celle du 2 février... •
• JCVD, c’est bien son truc de se perdre dans l’espace et le temps. Ici, le
voyage qu’il nous propose se fait à bord d’une voiture de course programmée par des scientifiques, vous l’aurez compris une version améliorée de la DeLorean. En l'an 2004, l'homme est enfin
parvenu à maîtriser les voyages dans le temps. Mais une nouvelle espèce de criminels est née à la faveur de cette invention miracle. Un individu mal intentionné peut en effet désormais
manipuler à sa guise les évènements historiques ou les marchés financiers, exploiter à ses propres fins une découverte scientifique ou militaire, compromettre l'avenir de son pays, provoquer
une guerre mondiale... Pour prévenir de tels abus, les Etats-Unis ont créé à Washington la Time Enforcement Comission, une unité d'élite chargée de contrôler et d'interdire toute
tentative de déplacement temporel. Les propres agents TEC ne sont cependant pas à l'abri des tentations... Bon, d’accord, c’est un véritable fourre-tout, mais certaines pistes auraient pu être
intéressantes.
JCVD, c’est bien son truc de se perdre dans l’espace et le temps. Ici, le
voyage qu’il nous propose se fait à bord d’une voiture de course programmée par des scientifiques, vous l’aurez compris une version améliorée de la DeLorean. En l'an 2004, l'homme est enfin
parvenu à maîtriser les voyages dans le temps. Mais une nouvelle espèce de criminels est née à la faveur de cette invention miracle. Un individu mal intentionné peut en effet désormais
manipuler à sa guise les évènements historiques ou les marchés financiers, exploiter à ses propres fins une découverte scientifique ou militaire, compromettre l'avenir de son pays, provoquer
une guerre mondiale... Pour prévenir de tels abus, les Etats-Unis ont créé à Washington la Time Enforcement Comission, une unité d'élite chargée de contrôler et d'interdire toute
tentative de déplacement temporel. Les propres agents TEC ne sont cependant pas à l'abri des tentations... Bon, d’accord, c’est un véritable fourre-tout, mais certaines pistes auraient pu être
intéressantes.

 •
• Personnellement, je n’ai pas aimé, surtout à cause de
l’idéologie dont cette version se fait le témoin, mais difficile tout de même de ne pas la faire figurer sur cette liste. L’histoire est la suivante : A New York, en 1899, Alexander
Hartdegen, un brillant physicien de l'Université de Columbia, fait la connaissance d'Emma, une charmante demoiselle dont il tombe follement amoureux. Un soir, dans Central Park, il trouve le
courage de lui déclarer sa flamme et de lui offrir une bague de fiançailles. Un voleur tente alors de dérober le fameux bijou, mais Emma ne se laisse pas faire. Un coup de feu retentit, la
malheureuse s'effondre et meurt dans les bras d'Alexander.
Personnellement, je n’ai pas aimé, surtout à cause de
l’idéologie dont cette version se fait le témoin, mais difficile tout de même de ne pas la faire figurer sur cette liste. L’histoire est la suivante : A New York, en 1899, Alexander
Hartdegen, un brillant physicien de l'Université de Columbia, fait la connaissance d'Emma, une charmante demoiselle dont il tombe follement amoureux. Un soir, dans Central Park, il trouve le
courage de lui déclarer sa flamme et de lui offrir une bague de fiançailles. Un voleur tente alors de dérober le fameux bijou, mais Emma ne se laisse pas faire. Un coup de feu retentit, la
malheureuse s'effondre et meurt dans les bras d'Alexander. Directement inspirée d’une
Directement inspirée d’une Teenmovie
Teenmovie A mon sens, c’est un peu idiot d’avoir intitulé le film ainsi car tout
semble dit. Mais vu que je suis bon public, en voici quand même la trame élimée : Alors qu'il enquête sur l'explosion d'une bombe sur un ferry à la Nouvelle Orléans, l'agent Doug Carlin se
voit enrôlé au sein d'une nouvelle cellule du FBI ayant accès à un appareil gouvernemental top secret permettant d'ouvrir une "fenêtre sur le temps", et ainsi de retrouver les preuves
nécessaires à l'arrestation d'importants criminels. Cette fenêtre permet d'observer des évènements dans le passé s'étant déroulés quatre jours, six heures et quelques minutes auparavant… Durant
son investigation, Doug va découvrir que ce que la plupart des gens pensent n'être qu'un effet de leur mémoire est en fait un don bien plus précieux, une force qui le mènera vers une course
contre la montre pour sauver des centaines d'innocents.
A mon sens, c’est un peu idiot d’avoir intitulé le film ainsi car tout
semble dit. Mais vu que je suis bon public, en voici quand même la trame élimée : Alors qu'il enquête sur l'explosion d'une bombe sur un ferry à la Nouvelle Orléans, l'agent Doug Carlin se
voit enrôlé au sein d'une nouvelle cellule du FBI ayant accès à un appareil gouvernemental top secret permettant d'ouvrir une "fenêtre sur le temps", et ainsi de retrouver les preuves
nécessaires à l'arrestation d'importants criminels. Cette fenêtre permet d'observer des évènements dans le passé s'étant déroulés quatre jours, six heures et quelques minutes auparavant… Durant
son investigation, Doug va découvrir que ce que la plupart des gens pensent n'être qu'un effet de leur mémoire est en fait un don bien plus précieux, une force qui le mènera vers une course
contre la montre pour sauver des centaines d'innocents.

 devenu un impossible messie. De l’idole noire au mensonge pieux, le pas est franchi.
L’Amérique n’est plus lumineuse ni tout à fait irréprochable sur le plan moral et il s’agit de le justifier. Comme toujours, le cinéma arrive à point nommé. Le propos devient alors
machiavélique : les données de la politique sont impures par essence et le sage (le bon) est impuissant à faire régner l’ordre. L’unité et la stabilité de l’Etat constituent des fins en soi
que seul l’exercice de la force permet d’atteindre. Alors, si pour assurer la pérennité de l’Etat, le prince doit parfois commettre des actes immoraux, qu’importe. On ne fait pas d’omelettes sans
casser d’œufs et il faut parfois se salir les mains pour agir efficacement.
devenu un impossible messie. De l’idole noire au mensonge pieux, le pas est franchi.
L’Amérique n’est plus lumineuse ni tout à fait irréprochable sur le plan moral et il s’agit de le justifier. Comme toujours, le cinéma arrive à point nommé. Le propos devient alors
machiavélique : les données de la politique sont impures par essence et le sage (le bon) est impuissant à faire régner l’ordre. L’unité et la stabilité de l’Etat constituent des fins en soi
que seul l’exercice de la force permet d’atteindre. Alors, si pour assurer la pérennité de l’Etat, le prince doit parfois commettre des actes immoraux, qu’importe. On ne fait pas d’omelettes sans
casser d’œufs et il faut parfois se salir les mains pour agir efficacement.
 («Certains hommes veulent juste voir le monde partir en flammes », ou encore, dans une distorsion nietzschéenne,
« Ce qui ne te tue pas te rend plus étrange ».). La haine et la détermination des ennemis – et comment ne pas penser ici à Al-Qaïda ? – seraient donc insensées et dénuées
de tout principe (voir la scène d’introduction où le gardien de la banque hurle au sol : « avant ici, les criminels avaient des principes au moins ! » ; voir aussi la
séquence plutôt explicite où apparait un camion de pompier en flammes). Ici, on cherche à occulter ou réduire à néant ce qui fonde l’idéologie terroriste. (A contrario et derrière sa folie, le
Joker de Burton avait, lui, des principes : pouvoir, argent, conquêtes, conception de l’art contemporain…). Dans le même temps, la figure du Joker étant décidemment bien commode, ce
mécanisme vient valider le discours ultra-sécuritaire prôné par l’administration Bush.
(«Certains hommes veulent juste voir le monde partir en flammes », ou encore, dans une distorsion nietzschéenne,
« Ce qui ne te tue pas te rend plus étrange ».). La haine et la détermination des ennemis – et comment ne pas penser ici à Al-Qaïda ? – seraient donc insensées et dénuées
de tout principe (voir la scène d’introduction où le gardien de la banque hurle au sol : « avant ici, les criminels avaient des principes au moins ! » ; voir aussi la
séquence plutôt explicite où apparait un camion de pompier en flammes). Ici, on cherche à occulter ou réduire à néant ce qui fonde l’idéologie terroriste. (A contrario et derrière sa folie, le
Joker de Burton avait, lui, des principes : pouvoir, argent, conquêtes, conception de l’art contemporain…). Dans le même temps, la figure du Joker étant décidemment bien commode, ce
mécanisme vient valider le discours ultra-sécuritaire prôné par l’administration Bush.
 Le Mal nouveau serait donc arrivé, celui qui se marre en
faisant sauter les hôpitaux. Comme nous l’avons dit, certaines concessions (morales) s’imposent pour combattre ce fléau moderne. Le destin de Batman sera désormais d’évoluer dans les nuances,
entre chien et loup, à la limite de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas, à la frontière du bien et du mal. Son masque lui-même semble faire la gueule, mais il faut bien s’occuper du sale
boulot. Déjà, dans le premier opus de Nolan (Batman Begins), Batman devait s’imprégner du mal pour le combattre. Dans The Dark Knight, il est à la limite d’en faire partie, par
nécessité. Car, puisque ce qui fonde l’identité du mal s’est métamorphosé, l’antidote doit lui aussi évoluer. Le remède, alors, devient ambigu, trouble et surtout peu compréhensible pour
l’opinion publique très moraliste des américains. (On détruit symboliquement le phare qui appelle Batman dans la nuit, même constat lors de l’épisode des bateaux lorsque le
Le Mal nouveau serait donc arrivé, celui qui se marre en
faisant sauter les hôpitaux. Comme nous l’avons dit, certaines concessions (morales) s’imposent pour combattre ce fléau moderne. Le destin de Batman sera désormais d’évoluer dans les nuances,
entre chien et loup, à la limite de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas, à la frontière du bien et du mal. Son masque lui-même semble faire la gueule, mais il faut bien s’occuper du sale
boulot. Déjà, dans le premier opus de Nolan (Batman Begins), Batman devait s’imprégner du mal pour le combattre. Dans The Dark Knight, il est à la limite d’en faire partie, par
nécessité. Car, puisque ce qui fonde l’identité du mal s’est métamorphosé, l’antidote doit lui aussi évoluer. Le remède, alors, devient ambigu, trouble et surtout peu compréhensible pour
l’opinion publique très moraliste des américains. (On détruit symboliquement le phare qui appelle Batman dans la nuit, même constat lors de l’épisode des bateaux lorsque le
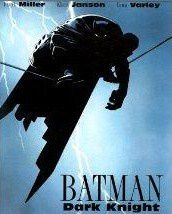 Pour finir, on ne sera guère surpris d’apprendre que le
scénariste et dessinateur actuel du Batman version comics, Frank
Pour finir, on ne sera guère surpris d’apprendre que le
scénariste et dessinateur actuel du Batman version comics, Frank 
 Un roi tyrannique et mégalomane,
Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize, règne sans partage et avec une certaine cruauté sur le royaume de Takicardie. Ce roi déteste les oiseaux et les martyrise à l’envie, notamment la
famille de l’oiseau-narrateur, à la verve subtile (Ca, Prévert avait une sacrée plume). De même, il fait disparaitre dans des trappes tous ceux qui ne lui reviennent pas (cf Le père
Ubu). Dans son royaume, les sculptures et les peintures qui le représentent sont innombrables et mettent parfaitement en lumière l’utilisation de l’art par la dictature. Une nuit, dans sa
chambre, le roi est troublé par le portrait d’une charmante bergère, juste à côté d’un autre tableau qui représente un ramoneur que le souverain déteste. Lorsqu’il s’endort, le roi se retrouve en
rêve avec les portraits des tableaux qui alors s’animent. L’illusion est si forte que le roi en oublie qu’il ne s’agit que d’un simple songe. Dans celui-ci, la bergère et le ramoneur s’aiment
mais le roi a juré d’épouser la bergère avant minuit. Le couple est alors emprisonné et, aidé par l’Oiseau, va tenter de recouvrer sa liberté…
Un roi tyrannique et mégalomane,
Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize, règne sans partage et avec une certaine cruauté sur le royaume de Takicardie. Ce roi déteste les oiseaux et les martyrise à l’envie, notamment la
famille de l’oiseau-narrateur, à la verve subtile (Ca, Prévert avait une sacrée plume). De même, il fait disparaitre dans des trappes tous ceux qui ne lui reviennent pas (cf Le père
Ubu). Dans son royaume, les sculptures et les peintures qui le représentent sont innombrables et mettent parfaitement en lumière l’utilisation de l’art par la dictature. Une nuit, dans sa
chambre, le roi est troublé par le portrait d’une charmante bergère, juste à côté d’un autre tableau qui représente un ramoneur que le souverain déteste. Lorsqu’il s’endort, le roi se retrouve en
rêve avec les portraits des tableaux qui alors s’animent. L’illusion est si forte que le roi en oublie qu’il ne s’agit que d’un simple songe. Dans celui-ci, la bergère et le ramoneur s’aiment
mais le roi a juré d’épouser la bergère avant minuit. Le couple est alors emprisonné et, aidé par l’Oiseau, va tenter de recouvrer sa liberté…

 D’emblée, on plonge dans un univers hautement surréaliste et ultra poétique. Le dessin
de Grimault est original et somptueux, il distord les perspectives, favorise les grands espaces architecturaux « à la Salvatore Dali » ou « à la Giorgio de Chirico », et
pousse à l’excès les antagonismes (haut/bas, endroit/envers, etc.). Il esquisse ainsi le tableau saisissant d’un royaume hybride principalement caractérisé par l’hubris et le colossal.
(A titre personnel, j’ai cru reconnaitre certains
D’emblée, on plonge dans un univers hautement surréaliste et ultra poétique. Le dessin
de Grimault est original et somptueux, il distord les perspectives, favorise les grands espaces architecturaux « à la Salvatore Dali » ou « à la Giorgio de Chirico », et
pousse à l’excès les antagonismes (haut/bas, endroit/envers, etc.). Il esquisse ainsi le tableau saisissant d’un royaume hybride principalement caractérisé par l’hubris et le colossal.
(A titre personnel, j’ai cru reconnaitre certains Apologie de la liberté
Apologie de la liberté


 Chanteur, compositeur et auteur de chansons qui
ont la classe façon Pimp, ce roi de la soul restera une vraie légende du son des années 60 - 70. Musicien phare de la soul music, au même titre que Otis Redding,
Chanteur, compositeur et auteur de chansons qui
ont la classe façon Pimp, ce roi de la soul restera une vraie légende du son des années 60 - 70. Musicien phare de la soul music, au même titre que Otis Redding,  La liste de ses compositions musicales pour le cinéma est impressionnante, de
La liste de ses compositions musicales pour le cinéma est impressionnante, de




 d. Le jeu de la
mort.
d. Le jeu de la
mort.
 h. Boulevard de la mort.
h. Boulevard de la mort.
 l. Déjà
mort.
l. Déjà
mort.
 p.
Mort d’un pourri.
p.
Mort d’un pourri.
 t. L’amour à
mort.
t. L’amour à
mort.